La
véritable histoire du France
En 1835, le gouvernement français prend conscience de
l’absence de liaison maritime avec le nouveau monde. Le premier service de
bateaux-poste entre le Havre et New York fut créé cette année là. La traversée
était assurée par des voiliers américains de faible capacité (450 tonnes). Ce
succès encouragea les armateurs à construire des unités de plus fort tonnage.
Les Anglais ayant inauguré un service entre la Grande-Bretagne et les
Etats-Unis, la France décida à son tour de se lancer dans le transport de
voyageurs. Le gouvernement français refusa d’abandonner aux autres le monopole
des relations transatlantiques et le 24 juin 1848, le port du Havre1
recevait le premier navire de service.
Les constructions des années suivantes se dérouleront
dans les cales de Penhoët situées à Saint-Nazaire. Dès 1840, il est décidé
d’aménager un nouveau port pour les grands navires. Le chantier qui occupe 5
hectares en 1869 se développera pour en occuper une centaine. Pour faire face à
la concurrence les chantiers de Penhoët fusionneront avec ceux de la Loire pour
donner naissance aux chantiers de l’Atlantique. ; plus
de 10500 personnes y seront alors employées. Dès sa création en 1861, la
Compagnie Générale Transatlantique (CGT) s’engagea à assurer la ligne de
l’Atlantique Nord pour le plus grand prestige de la France avec la construction
d’une quarantaine de paquebots, qui en un siècle donneront au monde l’image du
raffinement français.
 L’histoire du « France »
est complexe car les différents articles parus depuis des décennies mélangent
en fait plusieurs types de constructions sans chronologie précise. Quelques
articles de fond dénoncent les aspirations d’une population désireuse de
prendre du bon temps dès le début des voyages transatlantiques en opposition
avec celle d’aujourd’hui qui valorise les transports rapides à coût low cost.
En fait, trois paquebots auront le nom de « France ».
Ils porteront en eux toutes les innovations techniques du moment avec le luxe
des cabines à « La Française ».
L’histoire du « France »
est complexe car les différents articles parus depuis des décennies mélangent
en fait plusieurs types de constructions sans chronologie précise. Quelques
articles de fond dénoncent les aspirations d’une population désireuse de
prendre du bon temps dès le début des voyages transatlantiques en opposition
avec celle d’aujourd’hui qui valorise les transports rapides à coût low cost.
En fait, trois paquebots auront le nom de « France ».
Ils porteront en eux toutes les innovations techniques du moment avec le luxe
des cabines à « La Française ».
-
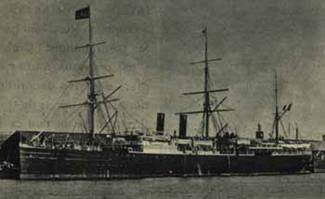 France 1,
premier du nom : paquebot en fer, construit à Penhoët, 108 mètres de long,
850 chevaux, 13 nœuds (24km/h) ; inauguré le 1er octobre 1864.
Il sera allongé de 12 mètres, on lui enlèvera ses roues à aubes en 1874.
France 1,
premier du nom : paquebot en fer, construit à Penhoët, 108 mètres de long,
850 chevaux, 13 nœuds (24km/h) ; inauguré le 1er octobre 1864.
Il sera allongé de 12 mètres, on lui enlèvera ses roues à aubes en 1874.
Sur cette photo, un troisième mât est ajouté.
Entre deux voyages, il participera à l’expédition du Tonking. Il sera vendu à
la démolition en 1910.
Peu
de documents retracent son épopée et les photos sont rares à cette époque. Le
début du 20eme siècle voit se développer, la construction d’immenses
paquebots. En Angleterre avec la construction de » l’Olympic » et du « Titanic2 » ; en France avec le « Normandie »
et « La Picardie » qui deviendra « Le France » N°2.
1)
Le port du Havre fut choisit au
détriment de Nantes, car avec l’accroissement de la taille des bateaux, cela
rendait la navigation dans l’estuaire de la Loire très difficile.
2)
Le Titanic : paquebot de 2603
passagers qui coulera au large de Terre-Neuve le 15 avril 1912.
-
France
2,
deuxième du nom.
Dès 1912, le Royaume
Uni connait les drames du Titanic, avec celui du « Lusitania »
torpillé par un sous-marin allemand en 1915, suivit de l’incendie du « Queen
Elizabeth » au large de Hong-Kong. Côté français, le paquebot « Paris »
brule et chavire dans le port du Havre. Pour répondre à une clientèle désireuse
de voyager dans le confort, la Compagnie Générale Transatlantique apporte au
transport maritime le moyen de traverser l’Atlantique dans le luxe avec un
deuxième « France » .
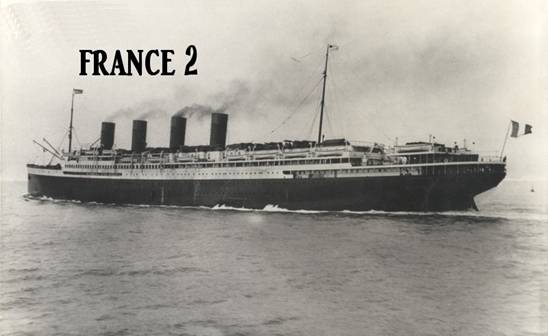
Après la seconde guerre mondiale, la
question de construire de grands navires se pose en termes économiques face au
développement sans précédent du transport aérien. Même si les vols sont longs
et couteux entre Paris et New York avec un confort encore assez limité, on
voyage en Constellation depuis 1946 à 520 km/h et on évoque dès 1956, un
nouveau modèle que prépare la firme Boeing : le 707 qui doublera
pratiquement cette vitesse de croisière. De son côté, la Compagnie Générale
Transatlantique lance en 1953, l’étude d’un nouveau paquebot appelé
« France ». Il sera le troisième du nom, encore plus grand et plus
beau.
-
France 3,
troisième du nom.
Que des tergiversations pour prendre la décision de construire ce navire. La décision finale fut prise en 1956, pour une mise à l’eau en 1960. Ce laps de temps va couter très cher car l’addition de 273 millions de francs à la commande va passer à 418 millions à la livraison3.

Il
y a 55 ans, plusieurs dizaines de milliers de visiteurs affluent à
Saint-Nazaire pour assister au lancement du plus grand paquebot du monde.
À propos du nom France, très vite une
querelle s'installe: faut-il dire «Le France», «La France» ou «France». Chacun
donne son avis. Finalement, la direction générale de la Transat tranche, on
doit dire «France» tout simplement.
« France »
comportait un bon nombre d’innovations techniques : chaudières à haute
pression, occasionnant une économie de carburant ; structures en alliage
léger d’aluminium permettant une plus grande vitesse ; ailerons
stabilisateurs de roulis ; cabines à air conditionné.
La
construction des cheminées s’achèvent le 11 mars 1961 par la pose des ailerons très
caractéristiques sur ce navire. Ceux-ci sont conçus pour éviter que la fumée ne
se rabatte sur le pont et donc sur les passagers en utilisant les vortex de
bout d’aile4. Les cheminées pèsent 40 tonnes, elles mesurent 15,60
mètres de haut et l’envergure des ailerons est de 19 mètres. La décoration
intérieure est terminée le 11 novembre 1961. Le 19 novembre, à 14 heures, il
quitte Saint - Nazaire pour le Havre, son port d’attache. Son premier
commandant est le capitaine au long cours Georges Croisile. Pendant 12 ans, il
assure les traversées transatlantiques et quelques croisières autour du monde.
3)
Le commandant du navire Christian Pettré
dénoncera plus tard, le manque de
décision de la compagnie qui placera le France dans une position commerciale
obsolète.
4)
Les vortex, bien connus en aviation
permettent un rejet de l’air vers le haut.
 La première traversée de
l’Atlantique à eu lieu le 3 février 1962, il y avait 1806 passagers, 580 en
première classe et 1226 en classe touriste. La traversée dura 5 jours dont 4
par gros temps. A son arrivée dans la rade de New York, le 8 février 1962, il
est salué par des milliers de personnes depuis les rives de l’Hudson. Quelques
années plus tard, l’équipage apprend lors de la traversée vers New York que la
compagnie a décidé la mise en vente du France. Il terminera sa vie au mois de
décembre 1974, quai de l’oubli. Déjà, fin 1965, les recettes sont pour la
première fois inférieures aux dépenses. Bien des paramètres n’ont pas été pris
en compte : le « Queen Elizabeth 2 » entre en service en 1969 et
devient un rude concurrent. La dévaluation du dollar fait perdre encore plus
d’argent. Les hausses du prix du carburant. Une politique de commercialisation
terne et bloquante. Les rigidités administratives avec l’interdiction de mettre
en place un casino. Le copinage dans les nominations avec un équipage trop
important. Les grèves à répétition avec leur opposition à tout changement.Circonstances aggravantes le 1er choc
pétrolier de 1973, avec le quadruplement du prix du baril. Cerise sur le
gâteau, Jacques Chirac suit les recommandations de VGE5 et stoppe
toute subvention. Le 24 octobre 1977, Akram Ojjch, riche saoudien achète le France
pour 80 millions de francs. Le 25 juin 1979, le norvégien Knut Ulstein
Kolsterle rachète pour 77 millions de francs. Le France quitte le Havre le 18
août 1979, remorqué par l’Abeille Provence. Il sera rebaptisé « Norway »
et continuera ses courses pendant 20 ans.
La première traversée de
l’Atlantique à eu lieu le 3 février 1962, il y avait 1806 passagers, 580 en
première classe et 1226 en classe touriste. La traversée dura 5 jours dont 4
par gros temps. A son arrivée dans la rade de New York, le 8 février 1962, il
est salué par des milliers de personnes depuis les rives de l’Hudson. Quelques
années plus tard, l’équipage apprend lors de la traversée vers New York que la
compagnie a décidé la mise en vente du France. Il terminera sa vie au mois de
décembre 1974, quai de l’oubli. Déjà, fin 1965, les recettes sont pour la
première fois inférieures aux dépenses. Bien des paramètres n’ont pas été pris
en compte : le « Queen Elizabeth 2 » entre en service en 1969 et
devient un rude concurrent. La dévaluation du dollar fait perdre encore plus
d’argent. Les hausses du prix du carburant. Une politique de commercialisation
terne et bloquante. Les rigidités administratives avec l’interdiction de mettre
en place un casino. Le copinage dans les nominations avec un équipage trop
important. Les grèves à répétition avec leur opposition à tout changement.Circonstances aggravantes le 1er choc
pétrolier de 1973, avec le quadruplement du prix du baril. Cerise sur le
gâteau, Jacques Chirac suit les recommandations de VGE5 et stoppe
toute subvention. Le 24 octobre 1977, Akram Ojjch, riche saoudien achète le France
pour 80 millions de francs. Le 25 juin 1979, le norvégien Knut Ulstein
Kolsterle rachète pour 77 millions de francs. Le France quitte le Havre le 18
août 1979, remorqué par l’Abeille Provence. Il sera rebaptisé « Norway »
et continuera ses courses pendant 20 ans.
Epilogue :
le 25 mai 2003 à Miami, le « Norway » est endommagé par l’explosion de
l’une des quatre chaudières causant la mort de plusieurs marins. La compagnie
norvégienne décide alors de vendre le bateau devenu non rentable. Il retourne à
Bremerhaven6 jusqu’au 10 août 2005 ; de là il effectue son
dernier voyage vers la Malaisie, à l’ouest de Kuala Lumpur ou il sera
débaptisé. Il devient le « Blue Lady » fin janvier 2006. Le 2 août
2006, la Cour suprême de l’Inde autorise le démantèlement du paquebot. En deux
jours, Artcurial7, vend aux enchères les 446 pièces de mobilier et
autres pour la somme de 937 800 €.
5)
 VGE
Valérie Giscard d’Estaing - 6) Port d’Allemagne - 7) Salle de vente à paris.
VGE
Valérie Giscard d’Estaing - 6) Port d’Allemagne - 7) Salle de vente à paris.